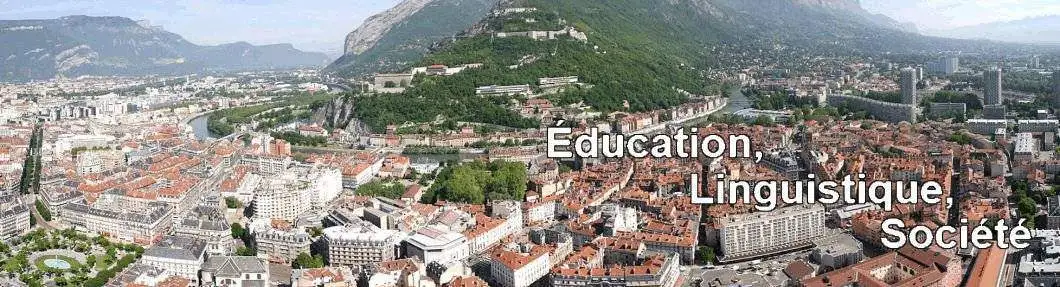Discours de Louis François - 11 juillet 1945
À peine revenu de Neuengamme, le protestant pur et dur Louis François (1904-2002), professeur agrégé d’histoire et géographie (futur inspecteur général de l'Instruction publique) et ami de Gustave Monod, prononce à la Sorbonne le premier discours de distribution des prix d'après la Libération ; en présence effective du général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, sous le commandement duquel il avait servi, en 40, comme officier du chiffre à la 4e division cuirassée. Et il ne met pas sa religion dans sa poche : on le note entre autres lorsqu'il cite Gabriel Audisio et Au sujet de Luc, 12.35 ! Quelle hauteur de vues, certes un peu austère. Et quels exemples cités, jusqu'à un Lazare Carnot !
Quelle leçon pour nous - et surtout pour ceux qui nous succèdent...
Quelle leçon pour nous - et surtout pour ceux qui nous succèdent...
"Après les ténèbres, nous voici donc dans la lumière. Durant cette longue nuit de cinq années, beaucoup ont dormi ; certains diront qu'ils avaient raison puisque la nuit est faite pour le sommeil. Mais il est des périodes de la vie où les tâches deviennent si importantes, si urgentes, qu'il faut travailler nuit et jour pour les accomplir".
L. François
L. François
Sauf le respect que je vous dois, Monsieur Bayrou...
En ai-je connu, au cours d'une longue carrière, commencée sous l'autorité de René Billères (membre du gouvernement Bourgès-Maunoury) des ministres de l'Éducation nationale ! Je n'ai pas précisément compté, mais assurément plus de trente. Je parle naturellement d'hommes (et de femmes, éventuellement) de sensibilités politiques diverses, mais possédant tous en commun une certaine tenue. Je ne saurais évoquer ceux qui, s'engouffrant dans la voie ouverte par le sinistre Lang, ont dévoyé la fonction, comme les Peillon, Hamon, Belkacem et autres Papa N'Diaye.
Il y eut de très grands ministres, tels Berthoin, Boulloche, Foucher, Haby (mais oui, mais oui), Beullac et autres Monory (mais oui, mais oui). Il y en eut de communs, évidemment. Mais celui qui m'est apparu très inférieur à sa fonction, ce fut le sieur Bayrou (prononcer Baillerou) qui vient d'être réélu à la tête du Modem - à la suite d'une assemblée générale tenue, paraît-il, dans une cabine téléphonique...
Cet être qui joue, et même surjoue, les vieux sages, ose tout, en réalité, et c'est à cela qu'on le reconnaît. Au centre, c'est-à-dire tantôt s'appuyant sur sa droite, tantôt sur sa gauche pour être au plus près de l'assiette au beurre, c'est surtout un opportuniste sans réelle colonne vertébrale, candidat permanent à la Présidence de la République - poste dont il ne possède pas, à l'évidence, l'étoffe pour l'occuper. Mais j'en reviens à son passage Rue de Grenelle où, lamentable suiveur, il n'eut d'autre problème que celui de plaire aux puissants syndicats et d'anticiper, même, le moindre de leurs désirs. Peut-être plus démagogue que Lang, ce qui n'est pas peu dire. Or, le voilà qui a fait la fine bouche, en février dernier, lorsque Macron lui proposa d'occuper à nouveau le poste, "faute d’accord profond sur la politique à suivre". Connaissant l'oiseau, on croit rêver.
Mais c'est un sentiment de profond mépris qui m'a envahi lorsque je l'ai vu serrer passionnément dans ses bras la dénommée Valérie Hayer à l'issue de son meeting à Lille, le 9 mars 2024. Cette illustre inconnue, qui a immédiatement fait le buzz à cause de son inculture sidérale - Hayer ou l'empire du vide, a titré le dernier Marianne - venait de cracher du haut de son incompétence, entre autres sur Édouard Daladier, premier agrégé de France en 1909 (histoire et géographie), un homme d'une culture, d'une compétence et d'une probité exceptionnelles. Or, Bayrou est incontestablement, lui aussi, un homme de culture : comment a-t-il pu congratuler aussi bruyamment une effroyable nullité, dont à coup sûr il avait à tout le moins perçu l'immense sottise ? Sinon par crasse démagogie ? "La liberté de penser, d'écrire et de parler peut être menacée, par exemple par des petits groupes d'activistes érigés en nouveaux censeurs" a récemment déclaré la nouvelle académicienne Sylviane Agacinski lors de son discours de réception. Cela n'est pas faux, mais laisse dans l'ombre la falsification cynique, ou la désinformation systématique opérée par des lobbies autrement plus puissants que de rares groupuscules d'activistes isolés.
C'est assez dire que le portrait que dresse de lui le vieil anar Carlier (dont je suis loin de partager sa raillerie de Pompidou et de Balladur) est plus vrai que nature...
Il y eut de très grands ministres, tels Berthoin, Boulloche, Foucher, Haby (mais oui, mais oui), Beullac et autres Monory (mais oui, mais oui). Il y en eut de communs, évidemment. Mais celui qui m'est apparu très inférieur à sa fonction, ce fut le sieur Bayrou (prononcer Baillerou) qui vient d'être réélu à la tête du Modem - à la suite d'une assemblée générale tenue, paraît-il, dans une cabine téléphonique...
Cet être qui joue, et même surjoue, les vieux sages, ose tout, en réalité, et c'est à cela qu'on le reconnaît. Au centre, c'est-à-dire tantôt s'appuyant sur sa droite, tantôt sur sa gauche pour être au plus près de l'assiette au beurre, c'est surtout un opportuniste sans réelle colonne vertébrale, candidat permanent à la Présidence de la République - poste dont il ne possède pas, à l'évidence, l'étoffe pour l'occuper. Mais j'en reviens à son passage Rue de Grenelle où, lamentable suiveur, il n'eut d'autre problème que celui de plaire aux puissants syndicats et d'anticiper, même, le moindre de leurs désirs. Peut-être plus démagogue que Lang, ce qui n'est pas peu dire. Or, le voilà qui a fait la fine bouche, en février dernier, lorsque Macron lui proposa d'occuper à nouveau le poste, "faute d’accord profond sur la politique à suivre". Connaissant l'oiseau, on croit rêver.
Mais c'est un sentiment de profond mépris qui m'a envahi lorsque je l'ai vu serrer passionnément dans ses bras la dénommée Valérie Hayer à l'issue de son meeting à Lille, le 9 mars 2024. Cette illustre inconnue, qui a immédiatement fait le buzz à cause de son inculture sidérale - Hayer ou l'empire du vide, a titré le dernier Marianne - venait de cracher du haut de son incompétence, entre autres sur Édouard Daladier, premier agrégé de France en 1909 (histoire et géographie), un homme d'une culture, d'une compétence et d'une probité exceptionnelles. Or, Bayrou est incontestablement, lui aussi, un homme de culture : comment a-t-il pu congratuler aussi bruyamment une effroyable nullité, dont à coup sûr il avait à tout le moins perçu l'immense sottise ? Sinon par crasse démagogie ? "La liberté de penser, d'écrire et de parler peut être menacée, par exemple par des petits groupes d'activistes érigés en nouveaux censeurs" a récemment déclaré la nouvelle académicienne Sylviane Agacinski lors de son discours de réception. Cela n'est pas faux, mais laisse dans l'ombre la falsification cynique, ou la désinformation systématique opérée par des lobbies autrement plus puissants que de rares groupuscules d'activistes isolés.
C'est assez dire que le portrait que dresse de lui le vieil anar Carlier (dont je suis loin de partager sa raillerie de Pompidou et de Balladur) est plus vrai que nature...
À propos de l'Éducation civique et morale
C'est pas pour dire, mais ils avaient de la gueule, les ministres de l’Éducation nationale d'antan ! Pour ne prendre que l'exemple de Jean Berthoin (1895-1979), ancien sénateur (radical) de l'Isère, ici ministre du gouvernement Mendès-France, quel souffle et quelle hauteur d'esprit, et même d'âme ! Un régal, ce discours, à méditer qui plus est ! Ah qu'ils avaient donc raison, les ineffables duettistes Baudelot/Establet, de nous seriner que le niveau monte !!!
"Des ébranlements de toute nature... ont amoindri la force de certaines traditions fondamentales, l'action régulatrice des influences sociales, et, ainsi, ont élargi pour certains le pouvoir, certes précieux, de se déterminer soi-même, mais parfois aussi ont conféré à d'autres la dangereuse licence de s'abandonner à l'égoïsme des intérêts ou à la spontanéité des penchants et des instincts".
J. Berthoin
J. Berthoin