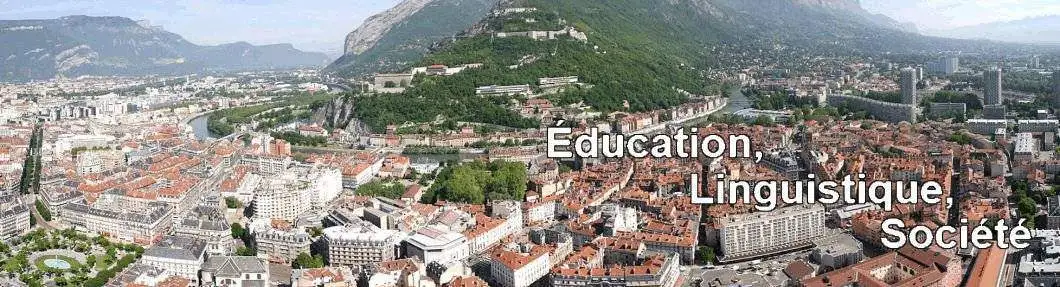![]()
Pourquoi utiliser l'ordinateur, ce matériel sophistiqué, pour l'étude de textes où l'intuition et l'expérience magistrales ont déjà fait leurs preuves ? Quel intérêt pédagogique peut bien trouver à ces pratiques rébarbatives un professeur de français ? Voilà à peu près les questions que se posent les nombreux collègues réticents à l'utilisation de l'outil informatique dans l'enseignement des lettres ; ces quelques lignes vont tenter d'y répondre.
Il faut d'abord noter que depuis une quinzaine d'années, des chercheurs utilisent l'ordinateur en économie, en géographie, en histoire, en arts plastiques, en musique, en linguistique ... et même en littérature. N'a-t-on pas vu récemment apparaître à Paris III un séminaire intitulé : "L'ordinateur au service de la littérature" ? Un des pionniers dans ce domaine a été l'Unité de Recherche "Lexicologie et textes politiques" de l'Institut National de la Langue Française, dirigée par Maurice Tournier, dont l'équipe a mis au point des méthodes et des logiciels de traitement de textes. C'est dans le cadre de cette URL et d'un projet de recherche INRP qu'une équipe d'enseignants s'est proposé de travailler sur les applications pédagogiques de ces méthodes au niveau de l'enseignement secondaire.
Actuellement, grâce à ces travaux - qui d'ailleurs se poursuivent - professeurs et élèves disposent, dans les lycées équipés, d'un ensemble de programmes : par exemple "TEXTE", le logiciel élaboré par Pierre Muller, leur permet de travailler sur des corpus déjà constitués, disponibles sur disquettes magnétiques, comme de constituer eux-mêmes leurs propres corpus.
Dans un cas comme dans l'autre, ils peuvent effectuer, sans compétence particulière en informatique, les recherches suivantes :
- l'index alphabétique(1) ;
- l'index hiérarchique(2) ;
ce faisant, l'utilisateur peut, à la demande, distinguer les formes lexicales(3) et les formes fonctionnelles(4), et obtenir, éventuellement, pour un corpus découpé en parties, la fréquence des "formes" dans chacune d'elles, la liste des formes communes et celle des formes propres à chaque partie ;
- les contextes de chaque forme du texte.
Précisons que ces résultats peuvent être obtenus sur écran, mais aussi sur papier, ce qui permet de travailler avec les documents hors de la salle de l'ordinateur, dans le cadre du cours traditionnel par exemple.
Apparemment, la machine ne semble apporter aucune donnée nouvelle. Ce n'est jamais que la surface du texte conçu comme une suite de caractères, qui est parcourue.
Pourtant, dans la pratique du cours de français, des avantages apparaissent : devant l'écran, l'élève mène, à l'aide de ce logiciel, une investigation personnelle sur le texte. Il pourra, par exemple, à partir de l'index hiérarchique d'un recueil de poèmes, explorer la thématique privilégiée de l'auteur en constituant divers champs lexicaux (voir document 1), étudier le jeu des pronoms personnels Je/Tu, Nous/On ... ; à partir de l'index alphabétique, comparer les vocabulaires d'un poème en vers et d'un poème en prose (ex. Baudelaire, "Un hémisphère dans une chevelure" et "La chevelure") ; à partir des contextes réunis sur un même support, étudier le voisinage syntagmatique d'un mot-clé (par exemple les occurrences d'amour dans la Chanson du Mal-Aimé) ou d'un mot-outil ("je", "comme", "pareil à" ... ). Autant de recherches dont il est erroné de prétendre qu'elles peuvent être faites à la main, sans lassitude et sans erreur, dans le cadre d'une heure de cours ! Muni d'un outil nouveau, l'élève, pour une fois, est mis réellement en situation de découverte rigoureuse, sans la médiation obligatoire du professeur, dont le rôle, indispensable cependant, se situe avant (préparation de la séance, sensibilisation à l'œuvre ... ) et après (exploitation et mise en commun des découvertes individuelles). Démarche heuristique, bien différente de l'EAO communément conçu comme un enseignement programmé mis sur ordinateur.
C'est aussi, pour l'élève, une autre "lecture" des textes, même les plus courts et les plus connus. En effet l'étude du lexique, à partir de l'index, objectif et exhaustif (la machine repère tous les mots), se révèle très profitable : rien n'est plus mal lu, en effet, que le "morceau choisi d'une vingtaine de lignes" proposé à tout élève du second cycle pour le bien connu commentaire, linéaire ou composé. On sait bien que la lecture est le plus souvent partielle, partiale, subjective ... L'index qui rompt la chaîne syntagmatique, et morcelle le sens, suscite un intérêt renouvelé, un réel questionnement linguistique, une attention au Signifiant d'abord, ensuite seulement au(x) Signifié(s). Et le va-et-vient indispensable qui s'instaure entre la liste formelle (ensemble d'éléments discontinus) et l'énoncé (combinatoire originale de ces éléments), met au jour, non seulement les récurrences, la redondance, la richesse ou la pauvreté de tel champ lexical, mais encore la polysémie, l'emploi métaphorique ... Dans tous les cas, il ancre l'explication dans la rnatérialité du fonctionnement linguistique et sémantique, et garantit ainsi le commentaire contre la paraphrase(5).
Pour le professeur, l'utilisation de méthodes et techniques pédagogiques nouvelles doit être l'occasion de retours critiques sur ses pratiques coutumières et de réflexions interdisciplinaires (l'étude de "texte" n'est pas l'apanage des seuls littéraires).
L'avantage essentiel de l'emploi de l'informatique, à l'inverse de son utilisation dans la recherche, se situe.,en classe de lettres, surtout au plan méthodologique. Il convient d'en attendre une aide partielle, non un remède à toutes les carences. L'ordinateur n'est qu'un outil parmi d'autres, qui n'exclut pas d'autres pratiques pédagogiques. Sa technicité ne doit pas lui conférer de statut privilégié, mais il serait regrcttable que 1'enseignement se prive de ses possibilités, insuffisamment exploitées dans le domaine littéraire, alors qu'elle séduit déjà les enfants, sous forme de gadgets dérisoires, et aussi les éditeurs ...
Dans ce domaine, du matériel existe déjà, et certains l'utilisent avec profit. Cependant ces outils restent perfectibles suivant les besoins et les suggestions de chacun.
APOLLINAIRE ALCOOLS - INDEX HIÉRARCHIQUE - FORMES LEXICALES
| ô | 69 | jamais | 16 | blancs | 11 | cimetière | 9 |
| amour | 48 | temps | 16 | corps | 11 | dame | 9 |
| yeux | 47 | vont | 16 | eau | 11 | Dieu | 9 |
| nuit | 36 | femme | 15 | fleuve | 11 | doux | 9 |
| mains | 34 | feu | 15 | jardin | 11 | feuilles | 9 |
| ciel | 31 | matin | 15 | loin | 11 | fit | 9 |
| jour | 29 | mourir | 14 | lune | 11 | grand | 9 |
| morts | 28 | Rhin | 14 | toujours | 11 | heure | 9 |
| soleil | 28 | seul | 14 | vieux | 11 | jours | 9 |
| vie | 26 | astres | 13 | vois | 11 | lumière | 9 |
| deux | 24 | cheveux | 13 | air | 10 | mer | 9 |
| fait | 23 | étoiles | 13 | faut | 10 | monde | 9 |
| fleurs | 22 | flammes | 13 | fois | 10 | mortes | 9 |
| automne | 21 | mort | 13 | hommes | 10 | non | 9 |
| femmes | 21 | oiseaux | 13 | lentement | 10 | pensées | 9 |
| Paris | 21 | terre | 13 | mai | 10 | porte | 9 |
| beau | 20 | va | 13 | maintenant | 10 | printemps | 9 |
| cœur | 10 | vin | 13 | ombres | 10 | roses | 9 |
| soir | 20 | fruits | 12 | rire | 10 | rue | 9 |
| mal | 19 | oiseau | 12 | roi | 10 | sais | 9 |
| aime | 18 | sans | 12 | rose | 10 | sapins | 9 |
| vent | 18 | souviens | 12 | triste | 10 | tête | 9 |
| enfants | 17 | yeux | 12 | adieu | 9 | vents | 9 |
| ombre | 17 | ville | 12 | anges | 9 | vient | 9 |
| voix | 17 | ah | 11 | bras | 9 | villes | 9 |
| belle | 16 | aimé | 11 |
BIBLIOGRAPHIE
I. Quelques ouvrages de référence
Maingueneau D., Initiation aux méthodes de l'analyse du discours, Problèmes et perspectives, 1976.
Muller Ch., Initiation aux méthodes de la statistique linguistique, Paris, Hachette, 1973.
Muller Ch., Principes et méthodes statistiques lexicales, Paris, Hachette, 1977.
Prost A., Vocabulaire des proclamations électorales de 1881, 1885 et 1889, Paris, 1974.
Rey A., La lexicologie, Klincksieck, 1970.
Robin R., Histoire et linguistique, Paris, A. Colin, 1973.
Tournier M., 1848. Des ouvriers et des mots, Thèse d’État 1976, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
Tournier M., "Les mots conflits", article dans Le français aujourd'hui, numéro 58, juin 1982.
Collectif, Des tracts en mai 68. Mesures de vocabulaire et de contenu, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1975 ; réédition Champ Libre, 1978.
Revue MOTS, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques et les éditions du CNRS, 6 numéros parus depuis 1980.
II. Quelques articles récents de l'équipe INRP
Muller P., Sarrazin M., Valentin D., "Informatique et lecture des textes", Éducation et informatique, numéro 2, Cedic-Nathan, juin 1980.
Delamare A., Duchet N., Facea C., Muller P., Sarrazin M., Valentin D., Applications pédagogiques de la lexicologie (communication présentée au 2ème Colloque de lexicologie politique, St-Cloud, 1980, parue dans les actes du Colloque).
Valentin D., Muller P., Dossier "Informatique et enseignement du français", dans Le français aujourd'hui, décembre 1980.
Delamare A., Muller P., Sarrazin M., Valentin D., Utilisation des banques de textes dans l'enseignement secondaire (communication présentée au Congrès international "Computers in education", WCCE 1981, Lausanne, juillet 1981).
Delamare A., Exploitation de banques de données-textes. Apport méthodologique à la didactique littéraire, Actes des journées internationales sur l'éducation scientifique, Chamonix, 1982.
Dautrey Ph., Guelfucci J., "Deux discours constitutionnels du Général de Gaulle", Éducation et informatique, numéro 12, Cedic Nathan, sept. 1982.
Notes
(1) Liste des unités lexicales séparées par deux blancs, classées par ordre alphabétique et accompagnées de leur fréquence.
(2) Liste des unités lexicales séparées par deux blancs. classées par ordre de fréquences décroissantes.
(3) Liste des "mots pleins".
(4) Liste des "mots-outils" préalablement établie (code ENS St-Cloud).
(5) Pour plus de précisions, se référer aux divers comptes rendus d'expériences pédagogiques cités en bibliographie.
Texte soumis aux droits d'auteur - Réservé à un usage privé ou éducatif.
===> Pour compléter (et modifier) l'index hiérarchique présent supra, on consultera avec fruit "Quintessence d’Alcools, LE RECUEIL D’APOLLINAIRE À TRAVERS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES", d'Hubert de Phalèse (nom collectif d'une équipe d’enseignants-chercheurs utilisant les nouvelles technologies dans leurs travaux), 1996.