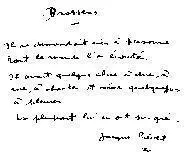
Il y a de grands bonshommes dont tout le monde peut parler. Et toi, Georges, tu étais, tu es, de ce lot rare. Je t'ai toujours connu : je suis né l'année où tu faisais tes débuts dans la chanson, mais je ne t'ai jamais parlé. Seulement salué d'un sourire quelquefois. En effet, vois-tu, ma femme et moi, nous avons été tes voisins à Paris pendant plusieurs années. Nous habitions à trois maisons de chez toi, dans cette petite rue à sens unique et déboîtée à mi-hauteur par un double coude. Nous passions devant ta porte et combien de fois avons-nous remarqué sur l'interphone - de même marque que ta maison de disques - l'étiquette blanche, impeccablement blanche, à côté du bouton. Nous t'avons croisé souvent. Nous avons patienté sur le trottoir un instant quand tu sortais ta "Mini" noire de ton garage ou qu'un de tes amis venait y garer une vieille 403.
Puis, un soir, vers cinq heures, tandis que je rentrais chez moi, dans cette rue peu passante, j'aperçus une voiture de RTL, je crois bien. Pour une émission en direct, Michel Drucker était venu te rendre visite à l'improviste. Mais la maison - dont jamais nous n'avons vu les volets clos, la large fenêtre du premier étage simplement tendue d'un dense et blanc rideau -, la maison devait être vide. L'animateur battait la semelle en cette fin d'hiver, en ameutant alentour toute âme qui vive. Ainsi il m'arrêta. Nous étions à l'antenne et il m'a demandé : "Vous savez qui habite ici ? - Bien sûr, et il veut vivre peinard. Comme tout le monde. Vous auriez dû faire comme nous : lui f... la paix". Drucker a bafouillé. Commandé un disque, peut-être. De qui ? J'étais déjà loin. Cette anecdote est peut-être méchante pour le bougre qui faisait son métier.
Mais, après tout - mince ! - tout le monde dans le quartier, une fois ou l'autre, a crevé, excuse-moi du mot, de l'envie de te rendre visite. Tout le monde s'est inventé un prétexte pour prendre contact, a imaginé qu'il buterait sur toi dans la rue. Tout le monde a échafaudé un petit dialogue vouvoyé, bien sûr, avec ce vieux, ce cher Brassens. Et personne, je crois, ne l'a fait. Tu sais, nous avons tous pris sur nous-mêmes et nous ne sommes pas allés t'emmerder. Alors celui-là qui gigotait avec son micro HF pour servir la soupe à des gogos... Même maintenant, tu vois, ça m'énerve. C'est vrai que toi, dans une autre propriété que tu as, tu as été le voisin de Bourvil. Et après qu'il fut mort - lui aussi, de cette saloperie -, tu as dit : "Pendant des années, je n'ai jamais osé aller le déranger chez lui". Oui, toi, Georges, non d'une pipe ! C'est pourquoi aussi on ne va pas fureter place Dauphine, par exemple, pour surprendre ton conscrit (et crois-moi que je ne suis pas seul à enrager de ne pas avoir trouvé de place à l'Olympia !). Je n'enverrai pas de mot à une grande Simone que j'admire et que j'aime. Vous tous, vous nous donnez assez. Ce supplément qu'il nous faut pour vivre. Ce n'est déjà pas mal, non ?
Je ne sais pas si ça te plaira que je te raconte cette histoire, mais je trouve qu'elle donne ta mesure. Un jour, tu as appris qu'un de tes amis avait besoin de quelques vieux millions pour acheter une maison. Et, quand tu l'as vu, tu lui as proposé la somme. Il a voulu s'asseoir pour te signer une reconnaissance de dette, au cas où quelque chose lui arriverait, a-t-il dit pour se justifier. Et tu lui as répondu : "Ce n'est pas la peine. Tu crois que, si tu meurs, c'est l'argent que je regretterai ?". Eh oui, c'était Brassens... (...) Aujourd'hui où l'encre devrait être plus noire que de coutume, elle est comme un mauvais vin. Elle est un peu coupée. Qu'est-ce que tu veux, si les poètes et les musiciens ne meurent jamais, les hommes, si, et ça fait vachement mal.
A. C. Roblin (Courrier des lecteurs, Nouvelles Littéraires n° 2 812, nov. 81).
